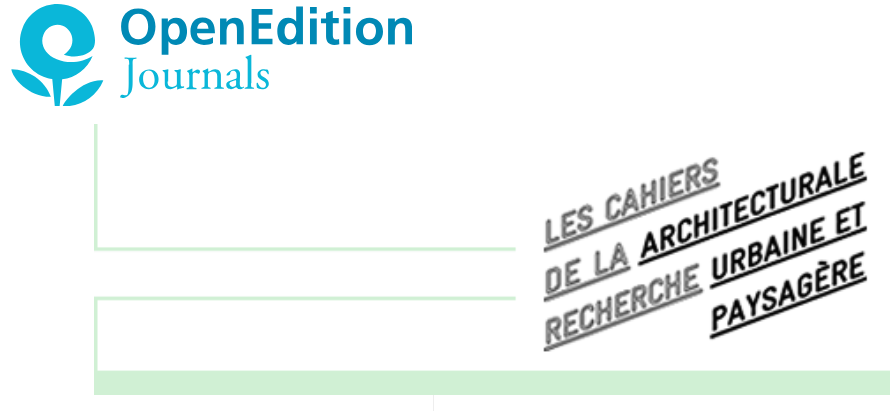N° 26 | L’Architecture et ses images numériques
Dossier coordonné par Sophie Fétro, Gabriele Pierluisi et Andrea Urlberger
Date limite de réception des propositions d’articles : 20 octobre 2025
Appel à articles
Introduction
Difficile d’envisager l’architecture sans sa visualisation et la production d’images : dessins, schémas, plans, coupes, isométries, axonométries, perspectives, etc. dont les modes d’obtention et de production peuvent s’avérer variés (crayon, calques, bleus, photographies, films, programmes informatiques, IA). Dans ce contexte, le recours au numérique, via les programmes informatiques, qui se banalise dans diverses pratiques en architecture depuis le début des années 1990, a ouvert la voie à d’autres modalités de représentation. Malgré son omniprésence et les mutations qu’elle connaît, l’image d’architecture, notamment numérique, fait l’objet de peu d’études, tandis que son rôle est souvent minimisé.
Si on assiste aujourd’hui à l’émergence et à la banalisation de l’intelligence artificielle générative, capable de produire par des descriptions textuelles (prompts)des images, il faut considérer ce tournant dans un enchaînement de « révolutions et hivers numériques », ponctué par l’avènement du paramétrique, la 3D, le BIM, la réalité virtuelle immersive, ou bien la réalité augmentée. Ces applications text-to-image telles que Midjourney, DALL-E, Canva, et leur généralisation rapide dans les métiers de la conception, viennent ainsi ajouter un nouveau type d’images jusque-là inédites, interrogeant les usages qui en sont faits et qui pourront en être fait à l’avenir.
Puisque la production numérique de l’architecture est une affaire de médium et d’un média particulier, essentiellement utilisé par le concepteur à travers une interface visuelle, parler d’images dans la production numérique de l’architecture peut facilement être assimilé à la production du projet lui-même. L’image, dans le numérique, en vient à concentrer la plupart des procédures techniques de production du projet lui-même. Même les « environnements de programmation visuelle », comme Grasshopper, semblent passer, dans ses développements les plus récents, par des structures visuelles (interfaces) qui renvoient le codage en arrière-plan. Cela démontre la prépondérance et l’étendue du sens de l’image dans les pratiques numériques de l’architecture. En d’autres termes, l’image est un champ visuel qui s’étend à la dimension productive du projet, tout en conservant sa fonction représentative.